Conformément à la réglementation (cf le Décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets), les conserves métalliques, y compris le couvercle et l’étiquette, sont des emballages entièrement recyclables. La matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente en effet plus de 95 % en masse du déchet collecté.
Le métal, utilisé pour fabriquer des boîtes de conserve, est un matériel permanent et recyclable. L’acier, comme l’aluminium, conservent leurs propriétés et leurs performances techniques à chaque recyclage. Source : Metal Packaging Europe
L’enjeu du recyclage des déchets
La question du recyclage des déchets ménagers est devenue, dans les années 90, un enjeu majeur des politiques publiques, tant en France qu’à l’échelle européenne. En 1992, un décret français a notamment obligé les entreprises responsables de la mise sur le marché d’emballages à pourvoir à leur valorisation.
Cela a entraîné la naissance d’Eco-Emballages, devenue aujourd’hui Citeo, entreprise privée agréée par l’Etat, dont la mission consiste à engager et accompagner les acteurs économiques à produire, distribuer et consommer en préservant notre planète, ses ressources, la biodiversité et le climat. Les fonds collectés financent le dispositif global de collecte, de tri de recyclage et le développement du réemploi des emballages en France.
Le métal, bon élève du recyclage
Dans cette filière du recyclage, le métal fait figure de bon élève. Tout d’abord parce que c’est un produit aisément recyclable. Contrairement à d’autres matériaux qui peuvent se dénaturer, l’acier comme l’aluminium qui constituent les boîtes de conserve, gardent leurs propriétés, leurs performances techniques. Une conserve pourra donc se « réincarner » en divers objets métalliques.
Autre atout : le tri des emballages métalliques est automatique. Ils ont pour eux d’être, la plupart du temps, mono-matériaux, et d’être récupérés aisément sur les tapis de tri. L’acier est attiré par de puissants électro-aimants. L’aluminium est, pour sa part, évacué de ces tapis par un champ magnétique à haute fréquence (grâce à une machine à courant de Foucault).
En conséquence, les emballages métalliques présentent un taux de recyclage remarquable : en Europe il est de 85,5 % pour l’acier. Source : APEAL, données 2020
En 30 ans, la conserve a allégé de 30% son contenant, tout en préservant les propriétés du contenant pour la sécurité du consommateur. Une réduction qui a permis d’économiser près de 24.000 tonnes de métal chaque année en France.
Une boîte qui limite la consommation des ressources naturelles
Le recyclage des emballages métalliques a une première conséquence positive évidente pour l’environnement : il permet de limiter la consommation de ressources naturelles (minerai de fer pour l’acier, bauxite pour l’aluminium) pour produire le métal.
Mais une autre voie donne également la possibilité de réduire la consommation de ressources naturelles : celle de la recherche sur la confection des emballages eux-mêmes. Les travaux menés par les industriels améliorent années après années les caractéristiques techniques et les performances de la conserve. Les scientifiques ont œuvré à l’allégement de la boîte, afin de réduire son volume et, par conséquent, de limiter la consommation de matières premières. Et les résultats sont là : en 30 ans, le poids moyen d’une boîte a perdu 30 % de son poids moyen, une réduction qui a permis d’économiser 24.000 tonnes d’acier chaque année en France.
Une boîte qui limite la consommation d’énergie et la pollution
En parallèle de la réduction des volumes de matières premières extraites, la consommation d’énergie et la pollution ont, elles aussi, diminué. Le recyclage d’une tonne d’acier permet ainsi d’éviter 1,5 tonne d’émissions nettes de CO2. Source : APEAL
Dans cette même recherche d’une moindre consommation d’énergie, la filière de la conserve alimentaire dispose d’un autre atout de poids : celui de privilégier une grande proximité entre les lieux de production et les lieux de mise en boîte. Ainsi, les conserveries se sont installées au plus près des champs de légumes, des vergers ou des zones de pêche, afin de limiter au maximum le temps entre la cueillette ou la pêche et celui de l’appertisation (4 heures en moyenne pour les légumes !). Les coûts et les émissions de CO2 liés au transport en sont donc réduits d’autant.
Enfin, on le sait, l’appertisation permet aux aliments d’être conservés à température ambiante. Qu’il s’agisse du transport des boîtes vers les lieux de vente, du stockage sur ces mêmes lieux de vente ou au domicile des consommateurs, nul besoin de respecter une chaîne du froid !








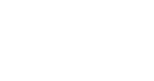 Elle n'a pas fini de vous étonner
Elle n'a pas fini de vous étonner